1. Vous avez introduit avec David Fayon dans le livre Développer votre présence sur Internet le terme de « passinaute » pour désigner les internautes passifs (les 89 % de la loi des médias participatifs ou 1/10/89) – ceux qui ne font que consulter l’information. Quels seraient selon vous les facteurs pour les inciter au partage et les faire devenir ambassadeurs 2.0 de leur entreprise ?
La question de la non-interaction des usagers des plateformes est complexe. Qu’est-ce qu’une interaction ? Est-ce le fait de cliquer sur un élément de l’interface ? De s’y connecter ? De produire du contenu ? Si on ne se focalise que sur le partage de documents (photos, pages web, commentaires, etc.), il est tout d’abord bon de noter que le développement continue des usages mobiles amène à une utilisation accrue des dispositifs web. La question serait alors : pourquoi partager quelque chose avec une organisation, et non pas « comment » ?
Il me semble que parmi les nombreuses interrogations qui peuvent être posées par les organisations, celle de la « rémunération » des publics est intéressante. Au-delà de la rémunération symbolique (être remercié ou mis en avant par l’organisation, obtenir du « fun » ou de la visibilité, ou en termes d’expression de soi), voire d’éventuels cadeaux (type jeux-concours), il manque actuellement de vraies compensations au travail fourni par les internautes. Si je génère de l’audience pour une organisation en lui partageant (par exemple) une photo, qu’est-ce que j’y gagne ? J’y perds un peu de ma vie privée, je fournis à la plate-forme des données nécessaires à son développement économique, et ensuite ?
Je ne pense pas que le web soit nécessairement fait pour s’exprimer (qui plus est avec des organisations) ou participer à l’accroissement des documents en ligne. Le problème (si problème il y a – la question des « audiences passives » n’étant pas neuve ou liée qu’au web) des organisations est qu’elles développent trop souvent une vision schématique du web et de ses usage(r)s : tout le monde peut et doit s’exprimer, les publics sont en attente d’une forme de relation avec les marques, etc. Ce qui attire souvent les organisations est la possibilité de mesurer plus finement les résultats et les interactions. Tout du moins, celles que les plateformes veulent bien laisser accessibles. C’est le cas pour la (e)réputation. Pour autant, réduire son public à une somme de « métriques » laisse souvent la place à un « vide » que l’on peut résumer à ces « passinautes », qui n’ont rien de passif mais qui développent des usages non-répertoriés ou mesurables dans des approches « RoIstes » de la communication web.
Bref, pour répondre (enfin 
2. Comment avez-vous vu évoluer les usages et les outils de curation ces 18 derniers mois et quelles perspectives voyez-vous se dessiner pour la veille ?
Les usages, comme les outils, me semblent aller dans une voie somme toute « classique » des outils de veille : émergence progressive d’acteurs « dominants » sur le marché, plus d’automatisation, et d’insertion pérenne desdits outils chez les utilisateurs les plus avertis. De plus, certaines plateformes comme Twitter commencent elles aussi à proposer des outils de ce type. En termes de perspectives, je ne peux rien prédire, mais encore une fois j’ai envie de prendre la question à contre-pied. La question des technologies importe moins que celle des pratiques associées et des formes de consommation de l’information. Archiver, mais pour quoi faire ? Le tout algorithmique ne fonctionne pas parfaitement (systèmes de recommandation), et le « tout manuel » demande parfois un temps considérable. En somme, plus que chercher un utopique « tous curateur », ces outils ne font que renforcer l’expertise de certains.
3. Depuis votre thèse et le concept d’agent-facilitateur, avez-vous poursuivi les recherches dans ce sens et qu’avez-vous repéré comme travaux intéressants pour l’analyse, la modélisation et la prédiction ?
Mes travaux continuent plus sur la question de ce que j’appelle « l’autorité réputationnelle ». Soit, quels sont les critères, les éléments qui me permettent de juger comme crédible/légitime/pertinente une source d’information ? Ce qui m’intéresse peut être abordé schématiquement selon 4 axes (une modélisation), qui associent infomédiaition sociale et (e) réputation :
– l’aspect documentaire : comment les éléments sémiotiques qui, par exemple, « s’attachent » aux profils d’un individu comme les (étoiles, J’aime ,volume de retweets, etc.) vont apparaitre comme des éléments d’autorité pour un utilisateur en recherche d’information ? Et donc faciliter par la suite la recommandation ;
– l’aspect « système » : soit la manière dont les « systèmes » des plates-formes (algorithmes, architecture logiciel, etc.) produisent de l’autorité et de la réputation, autant qu’ils se basent sur certains éléments pour favoriser la gouvernance informationnelle et diriger les usages ;
– l’aspect cognitif/émotionnel; La réputation est une perception qui suppose des mécanismes affectifs. Avec Julien Pierre notamment, nous nous interrogeons sur le développement d’un possible « capitalisme affectif » : comment les acteurs du web « collectent » et « exploitent » les émotions (tout du moins construisent statistiquement des « émotions ») ? On peut se référer à cet article;
– enfin la question managériale, qui interroge les pratiques de management de l’information par les organisations.
7 septembre 2015
Camille Alloing est Maitre de conférences en Sciences de l’information et de la communication à l’IAE de l’Université de Poitiers. Ses recherches portent sur la réputation des organisations et son pendant numérique (l’e-réputation). Il est auteur de ce blog Cadderep.



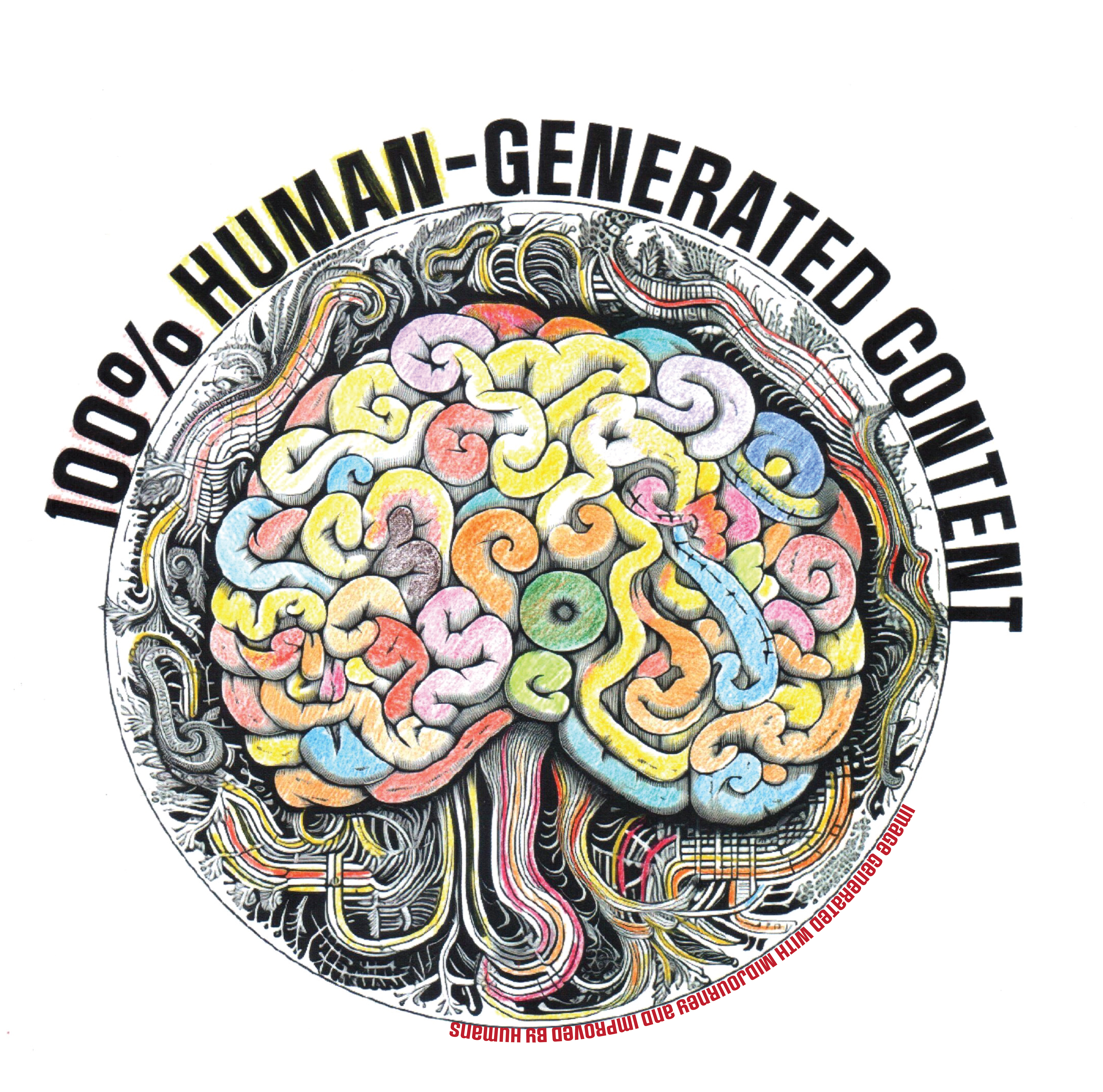




 Digital Impacts
Digital Impacts Editions des Cassines
Editions des Cassines Paperblog
Paperblog Renaissance numérique
Renaissance numérique
Commentaires récents